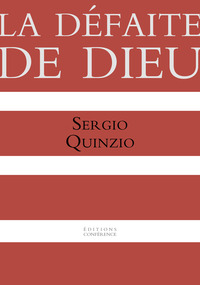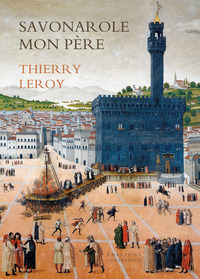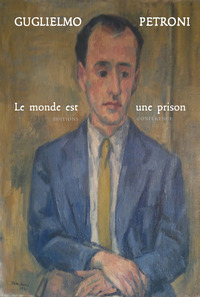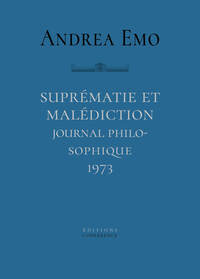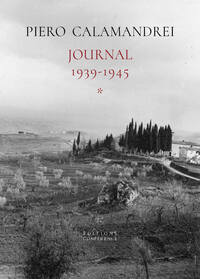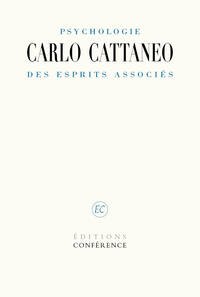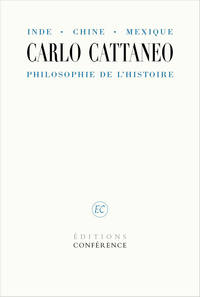Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.
Vérité et interprétation
Conference - EAN : 9791097497781
Édition papier
EAN : 9791097497781
Paru le : 16 janv. 2026
25,00 €
23,70 €
Bientôt disponible
Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous
A paraître 16 janv. 2026
Notre engagement qualité
-
 Livraison gratuite
Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande -
 Manquants maintenus
Manquants maintenus
en commande
automatiquement -
 Un interlocuteur
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes -
 Toutes les licences
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur -
 Assistance téléphonique
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique -
 Service client
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
- EAN13 : 9791097497781
- Collection : LETTRES D'ITALI
- Editeur : Conference
- Date Parution : 16 janv. 2026
- Disponibilite : Pas encore paru
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 272
- Format : H:15 mm L:160 mm E:225 mm
- Poids : 464gr
- Résumé : Pareyson, avec ce livre, dont la préface d’Arnaud Clément éclaire les enjeux, remet au centre du travail philosophique la question de la vérité, et, par suite, celle des modalités ou plutôt des exigences impérieuses de la connaissance. L’auteur, entretissant divers travaux dans le livre qui leur donne leur unité, s’emploie à une manière de démonstration dont on peut retracer les étapes inaugu-rales — résumer l’ensemble d’un tel ouvrage exigeant bien plus qu’une simple note. Pareyson fait tout d’abord de la négation de la vérité la marque de l’idéologie, et déclare pour ce motif la nullité absolue de l’idéologie en matière de connais-sance. Son intolérance sans compromis désigne l’idéologie comme l’ennemi mortel de la philosophie. La lutte à mort de ces deux adversaires s’enracine dans l’alternative fondamentale de l’être et du néant : les philosophes énoncent l’être de ce qui est, les idéologues ramènent ce qui est à la vacuité du non-être. Si l’idéologie contient quoi que ce soit de vrai, c’est qu’elle n’est déjà plus idéologie mais philosophie. Réciproquement, une philosophie qui nie la vérité se nie elle-même pour verser dans l’idéologie. La division entre philosophie et idéologie se ramène ainsi à un choix originaire pour ou contre la vérité. La première formulation magistrale de cette alternative se trouve chez Platon. De l’idéologue pareysonien, on pourrait dire qu’il était déjà chez Platon l’orateur ou le sophiste dont la réfutation constituait un enjeu vital pour la philosophie. La rhétorique repose sur la possibilité de parler sans dire la vérité, en jouant sur les apparences au mépris de ce qui est réellement. La sophistique fait un pas de plus en déclarant explicitement qu’il n’y a pas de réalité au-delà des apparences. Le mépris et la négation de la vérité sont donc les deux possibilités fondamentales qui s’offrent à la parole humaine pour faire concurrence à la philosophie qui, elle, af-firme la réalité par-delà les mots et les opinions. Mais la philosophie, à cause de son idéal de sagesse et de connaissance justifiée, ne peut pas se contenter de postu-ler l’être : elle doit le manifester dans la vérité et triompher par ce moyen de ses adversaires qui la dissimulent. Ainsi, dans son effort, elle est moins aux prises avec eux qu’avec elle-même. Leur contribution est nécessairement destructrice de la vé-rité ; mais en se réappropriant le discours des sophistes, en le portant au comble de ses prétentions, le philosophe en fait un moteur produisant le mouvement où la vé-rité finit par se révéler. C’est tout le génie de Platon que d’avoir su faire de la né-gation de la vérité un moment de sa production : la dialectique, jusqu’à Hegel, procède de ce travail du négatif. Le dialecticien, en partant d’une idée statique et abstraite de l’être, ne la nie pas pour aboutir à une autre idée inerte, mais pour accomplir dans ce parcours le mouvement où la vérité se révèle. Cette dynamique de la vérité prend chez Pareyson une allure qui n’est plus dialectique mais hermé-neutique : elle a pour moteur l’interprétation et non la négation. Quoique les termes de la lutte se soient déplacés, ses enjeux demeurent : dé-fendre la vérité, assurer la possibilité de la philosophie conçue comme pensée qui choisit la vérité, et par là manifester la nature sophistique des discours qui s’y op-posent. Avec des mots sévères, Pareyson juge qu’il n’y a aucune vérité à tirer des pensées idéologiques. Celles-ci peuvent bien énoncer le vrai — c’est-à-dire une proposition adéquate au réel —, elles ne saisissent jamais la vérité et n’aident pas à la dire, car tout ce qu’elles énoncent découle du choix premier de réduire la véri-té à l’histoire. La philosophie a pour tâche de redéployer le vrai à partir de la déci-sion originaire en faveur de la vérité. Tout procède de ce choix librement effectué par la personne humaine, celui-là même qu’avait fait Socrate et que chaque philo-sophe après lui renouvelle. « La distinction fondamentale et la plus importante, écrit Pareyson, est toujours le choix décisif entre rester fidèle à la vérité ou la tra-hir, entre se tenir à l’écoute de l’être ou l’oublier, que cela arrive dans la pensée ou dans l’action. » La personne choisit de rester fidèle à la vérité ou de la trahir. Ce choix n’est pas de nature dogmatique, au sens d’une thèse qui serait admise préalablement pour être écartée de la démarche de remise en question et servir à la déduction d’autres thèses. Le dogmatique n’est pas fidèle à la vérité, mais à une formulation qu’il con-fond avec elle ; la fidélité à la vérité implique qu’on la recherche dans ses formula-tions sans prétendre l’enfermer dans un système. C’est pourquoi il ne faut pas se représenter le choix comme un instant inaugural qui prescrirait une tâche au reste de l’existence, mais bien comme une vocation de chercher la vérité, une fidélité qui s’atteste par le renouvellement constant du vœu dans la théorie comme dans l’action. Le choix n’est pas un instant fictif qui se trouverait derrière nous et qui déterminerait nos actions ultérieures. Sa temporalité est le présent où la personne s’engage librement dans l’espoir que ce qu’elle entreprend servira à révéler la véri-té. L’alternative est donc entre l’ouverture et la fermeture. L’idéologue ne choisit pas véritablement : il s’enferme par son attitude dans un déni de la vérité qui le rend aveugle à sa manifestation. Le philosophe, lui, choisit de répondre à l’appel de la vérité. Pareyson reprend en ce point la leçon de Heidegger. Selon l’auteur d’Être et temps, le Dasein doit partir de la pré-compréhension qu’il a de l’être s’il veut ques-tionner en vue de son sens, procédant ainsi à une herméneutique du soi. Cette dé-marche fait de l’interprétation du sens le cœur de la méthode philosophique. Ce-pendant, l’herméneutique n’a plus pour objet premier le texte ni la tradition écrite : elle questionne le soi dans son ouverture à l’être, telle qu’elle se laisse appréhender dans les différentes déterminations de son existence (la vie quotidienne, l’ustensilité, l’être-pour-la-mort, l’angoisse, le temps…). Le soi se fait texte, matière d’une auto-interprétation qui n’a rien de psychologique car elle relève de l’ontologie, de l’interrogation en vue du sens de l’être. La finalité d’une telle interrogation n’est pas la connaissance de l’âme humaine, motif écarté par Heidegger, mais l’être lui-même que l’homme ne peut questionner qu’en partant du privilège qui est le sien d’exister en se souciant de son existence. Seulement, la quotidienneté détourne souvent le soi de cette fin pour le jeter dans la préoccupation de l’étant, ce qui constitue une modalité inauthentique de l’existence : il se perd dans les choses et manque son être véritable. L’attitude authentique ne peut consister qu’à répondre à l’appel de l’être qui est le destin du Dasein. C’est donc bien l’herméneutique heideggérienne de la différence ontologique qui constitue le cadre de la démarche de Pareyson. La vérité chez Pareyson signi-fie, comme chez Heidegger, la manifestation de l’être telle qu’elle se révèle dans l’existence concrète, historique, du soi. Pareyson reprend l’idée d’une vie philoso-phique tournée vers l’authenticité, concevant la fidélité à sa vocation comme la ré-vélation de la vérité manifestée dans son rapport à l’être. L’idée que la personne est liée à la vérité ne se fonde ni sur une mystique (l’âme divinement touchée par la vérité), ni sur l’onto-théo-logie métaphysique que Heidegger a définitivement réfu-tée, à savoir la pensée qui identifie l’être à Dieu. Ni l’être ni Dieu ne relèvent de la catégorie de l’étant, fût-il suprême. Les philosophes qui nient la vérité et ne veulent pas admettre un appel à la découvrir s’acharnent sur le cadavre de l’ancienne mé-taphysique qui ramenait toute vérité à l’étant suprême. Ils confondent la fin de cette idée de la vérité — que Nietzsche a annoncée avec verve à travers la mort de Dieu — et la fin de la vérité tout court. Or, l’herméneutique de Heidegger repose sur une tout autre conception de la vérité, rendue justement possible par la destruc-tion nietzschéenne des idoles et des arrière-mondes métaphysiques. La vérité se dé-voile au cours de l’histoire de l’être, qui est aussi l’histoire de son occultation. Sans souscrire entièrement à la condamnation radicale de la métaphysique par Heideg-ger, Pareyson reprend l’idée d’une révélation historique de la vérité dans les époques qui surent la formuler. C’est pourquoi le philosophe réfute l’idéologue en offrant son activité pour exemple de la fécondité de son choix en faveur de la vérité. L’idéologie est menée à sa fausseté par un jeu de miroirs qui en accuse les insuffisances. Il ne s’agit pas de mener la critique des idéologies en conduisant une polémique sur leur terrain, mais de reprendre l’histoire de la philosophie afin de manifester la vérité qui s’y lit malgré la diversité voire la contradiction des pensées qui l’ont faite. Renversant l’historicisme des idéologues qui rejettent la vérité éternelle en revendiquant le ca-ractère irréconciliable de ses diverses formulations, Pareyson fait de cette pluralité le vecteur essentiel de la révélation de la vérité.