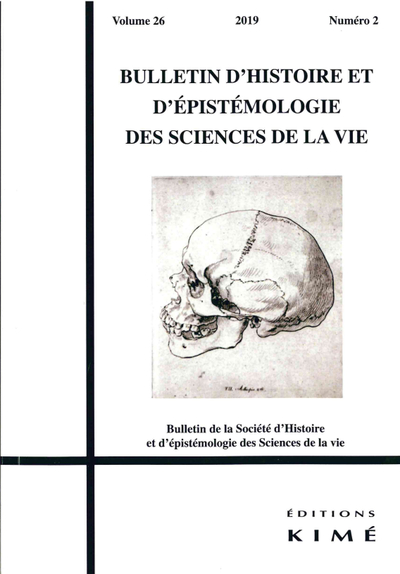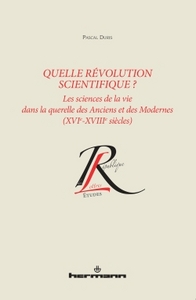Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.
BULLETIN D'HISTOIRE ET D'EPISTEMOLOGIE DES SCIENCES DE LA VIE N 26/2
Kime - EAN : 9782841749539
Édition papier
EAN : 9782841749539
Paru le : 22 nov. 2019
16,00 €
15,17 €
Disponible
Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous
Notre engagement qualité
-
 Livraison gratuite
Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande -
 Manquants maintenus
Manquants maintenus
en commande
automatiquement -
 Un interlocuteur
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes -
 Toutes les licences
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur -
 Assistance téléphonique
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique -
 Service client
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
- EAN13 : 9782841749539
- Editeur : Kime
- Date Parution : 22 nov. 2019
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 128
- Format : 1.00 x 14.60 x 21.10 cm
- Poids : 175gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Le second numéro du Bulletin de la SHESVIE reprendra le thème de l’anthropogénèse qui a animé le XXVe Congrès de la société et qui s’est déroulé à Bordeaux les 14-15 mars 2019. La question des origines de l’homme est une vraie interrogation depuis le XVIIIe siècle, en Occident. Jusque vers 1750, la question se pose en termes théologiques et dans une lecture des textes bibliques influencée par le nominalisme et le cartésianisme. Buffon est un des premiers à envisager une origine de l’homme intégrée dans le règne animal et à détacher les explications scientifiques des explications théologiques. A partir des années 1860, le concept de préhistoire s’élabore en tant que science et un questionnement anthropologique se met en place autour des types morphologiques humains passés ou présents. De la biologie darwinienne de l’évolution, bientôt enrichie et transformée par la génétique des populations à la paléoanthropologie, retraçant le parcours complexe et buissonnant de la phylogénie humaine ; de l’archéologie, interrogeant et datant les différents restes fossiles de cette histoire à la primatologie, donnant à voir la proximité chaque jour plus étonnante entre l’homme et les grands singes; toutes ces disciplines, au-delà de leur évidente disparité, convergent pourtant autour d’un même objet. Elles interrogent toutes à leur manière, depuis les méthodes qui sont chaque fois les leurs, l’humain et sa longue histoire constitutive. Peut-on néanmoins rapprocher ces « anthropogenèses » distinctes et les penser ensemble, comme autant de points de vue différents sur une même histoire ? Une interrogation transdisciplinaire, une réflexion commune sur notre humanité et sa préhistoire sont-elles aujourd’hui possibles ? Ce congrès se propose d’apporter des éléments de réponse à ces questions.